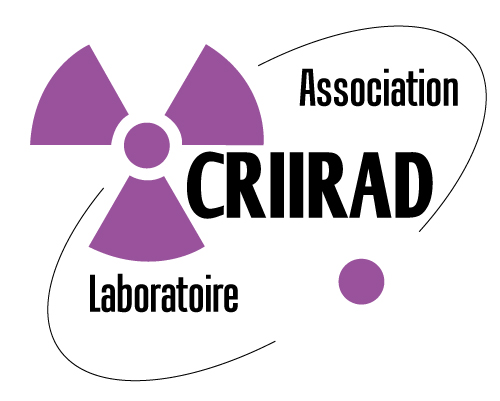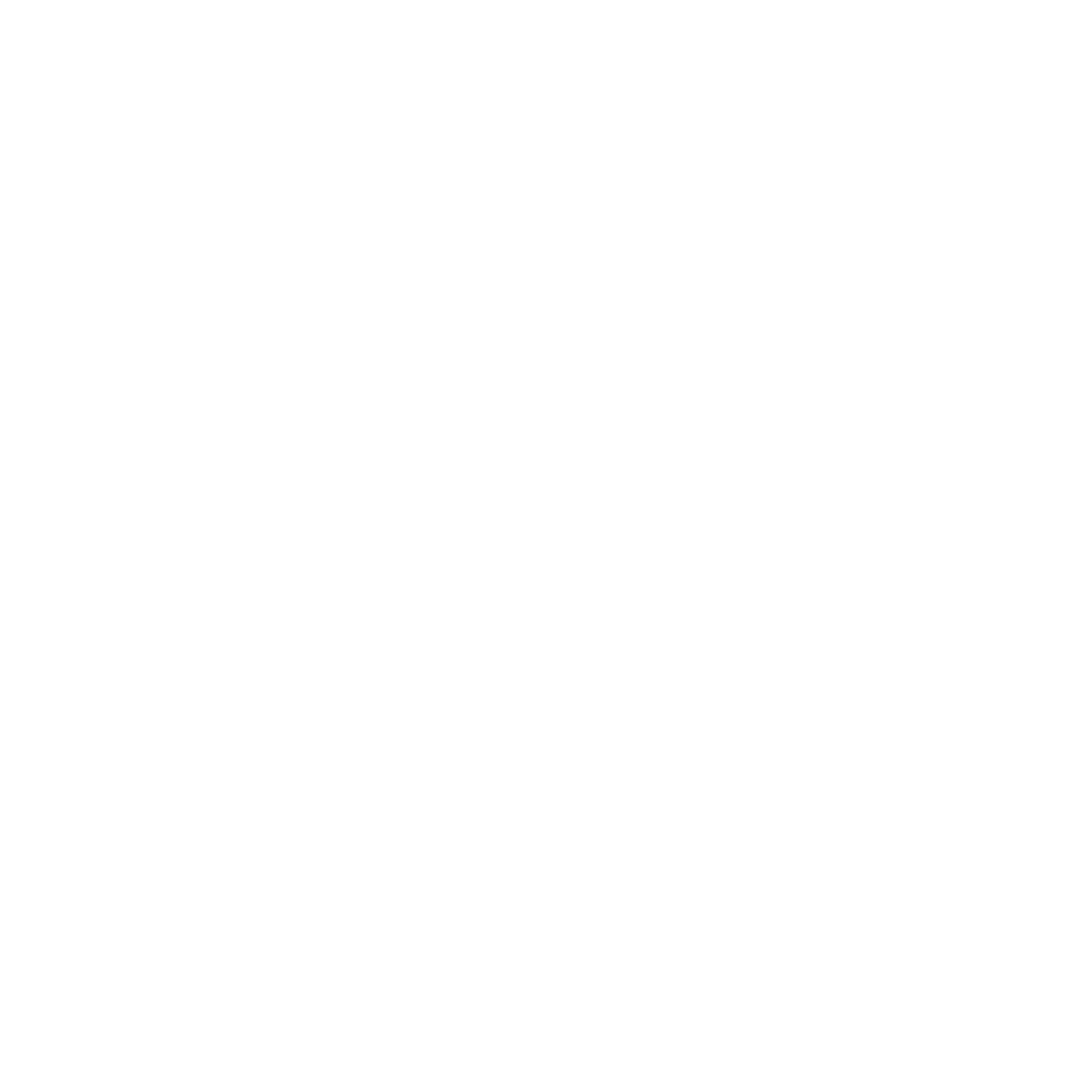🕒 Lecture 15 min.
Trop d’incertitudes pour une véritable protection
S’il voit le jour, le Technocentre de Fessenheim engendrera une dissémination irréversible de radioactivité dans le domaine public. La CRIIRAD poursuit son argumentaire scientifique et approfondit les raisons de son opposition à ce principe. Méthode biaisée, critères arbitraires et manque de connaissances faussent les estimations des effets des radiations.
Fondre certains déchets nucléaires, en récupérer le métal et le revendre ensuite aux aciéries, c’est le projet Technocentre d’EDF. Ce métal sera encore radioactif mais si certaines limites sont respectées (dites seuils de libération) (1), il pourra servir à fabriquer n’importe quel produit, sans restriction ni traçabilité.
Ce projet, une première en France, a été débattu durant 4 mois (2). Le compte-rendu et le bilan du débat viennent d’être communiqués. Ceux-ci pointent des besoins de clarifications sur le procédé industriel, les enjeux économiques et les impacts environnementaux. De nombreuses questions n’ont pas obtenu de réponses satisfaisantes, EDF ayant à plusieurs reprises opposé le secret industriel et commercial à la communication d’informations. Ceci conforte ce que nous avons dénoncé (3) : une absence de preuves scientifiques et un dossier trop peu étayé.
EDF a désormais 3 mois pour en tenir compte et décider de poursuivre ou non son projet.
À la veille de la clôture de ce débat, la CRIIRAD avait exprimé son opposition. Pour certains radionucléides, l’efficacité de la décontamination n’est pas prouvée et les mesures de radioactivité sont difficiles, voire impossibles. La conformité du métal n’est donc pas garantie.
D’autres raisons, plus profondes encore, justifient notre position. Même s’ils sont respectés, les seuils de libération ne garantiront pas que la dose reçue par les personnes exposées aux radiations soit sous la limite imposée par le code de la santé publique. Au fil du temps et des lieux de vie, les doses seront multiples et impossibles à estimer. Il est faux d’affirmer qu’il n’y aura aucun risque pour la santé. Alors que d’autres solutions permettraient de gérer ces déchets sans exposer le public, est-il acceptable d’augmenter volontairement le risque de maladies et de décès pour préserver les intérêts économiques de la filière nucléaire ?
1/ La limite fixée ne sera pas toujours respectée
Le métal produit au Technocentre sera encore radioactif. Cette activité radiologique devra rester en dessous de certaines valeurs (les seuils de libération). Elles sont supposées garantir que la dose (4) (l’indicateur utilisé pour évaluer le risque sanitaire) sera négligeable quel que soit l’usage de ce métal. C’est-à-dire que dans toutes les situations possibles et imaginables, dans toutes les configurations, les radiations n’induiront pas ou très peu de risques pour la santé. Cette limite de dose est inscrite dans le code de la santé publique (5).
Un périmètre d’étude restreint
Pour établir la correspondance entre activité radiologique et dose d’exposition, des experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique ont étudié quelques scenarios qu’ils ont eux-mêmes imaginés (6). Selon leurs propres critères et en nombre très limité (5 concernent l’exposition du public et 3 les professionnels). En se basant sur seulement 8 situations, les experts ont drastiquement limité leur champ d’étude. De plus, ces situations postulent une faible quantité de matériaux contaminés présente dans l’environnement (7). Les plus pénalisantes et celles susceptibles de concerner un petit nombre d’individus n’ont pas été retenues (8).
Des choix arbitraires
Pour ces quelques situations, les experts ont choisi ce qui leur semblait « réaliste » et là, la limite de dose est respectée (10 microsieverts/an, noté µSv/an). Pour ce qui leur paraissait « peu probable » en revanche, susceptible d’arriver dans moins de 1% des cas d’après eux, l’exposition peut générer une dose jusqu’à 100 fois plus importante (1 millisievert/an, noté mSv/an) (9). Cette dose est équivalente à la limite annuelle tolérée pour le public, toutes expositions aux activités nucléaires confondues (impacts des transports et rejets radioactifs, des sites contaminés, des stockages de déchets, etc.). Un seul scenario « peu probable » suffit donc à ce que la limite annuelle d’exposition soit dépassée.
Des paramètres inadaptés
Les paramètres choisis pour les situations dites réalistes sont largement critiquables. Ainsi, l’étude de l’exposition à domicile (qui ne contient que 10% de matériaux contaminés) est basée sur un temps de présence de 51% chez-soi (4 500 heures d’exposition aux radiations par an).
Or, en 2008, un quart de la population française passait plus de 80% de son temps à domicile (10). Ce qui fait quand même plus de 16 millions de personnes (11) exposées plus de 7 000 heures par an. C’était avant la démocratisation du télétravail. Et sans compter les multiples changements de société qui impactent les habitudes et les comportements (augmentation et vieillissement de la population, chômage et emplois à temps partiel, numérisation des loisirs et des outils, etc.).
L’étude de l’exposition d’un enfant qui passe du temps sur une aire de jeux construite à partir de matériaux contaminés comporte les mêmes écueils : pour le scénario réaliste seulement 10% de matériaux contaminés, et seulement 1 heure par jour d’exposition. Dans le « pire des cas » (le scenario dit peu probable), 50% de matériaux contaminés et l’enfant y passera 3 heures. Est-ce vraiment le pire des cas et est-ce vraiment si peu fréquent ? Combien d’enfants passent 3 heures par jour sur un terrain de jeux, voire plus lorsqu’ils sont en vacances ?
Une méthode biaisée
Très peu de scenarios, des valeurs arbitraires et des doses qui peuvent atteindre voire dépasser 1 mSv/an… Comment concilier cela avec la réglementation qui affirme que si les seuils de libération sont respectés personne ne recevra plus de 0,01 mSv/an ? Pour contourner ce problème, la solution trouvée par les experts (12) a été de diviser par 100 la dose générée dans les situations dites peu probables, qui n’arrivent qu’une fois sur 100. La probabilité d’apparition de la situation a été intégrée dans le calcul de la dose générée, ce qui n’a aucun sens, ni statistique, ni logique. Soit la situation se produit et la dose reçue est celle qui est générée par l’exposition, soit la situation ne se produit pas et personne n’est exposé aux radiations.
2 / Des cumuls impossibles à estimer
Les seuils de libération ne garantissent donc pas une exposition toujours inférieure à la limite fixée par le code de la santé publique. Ils ne permettront pas non plus une vision d’ensemble des expositions auxquelles nous serons soumis dans nos espaces de vie. Il faudrait pouvoir toutes les additionner, mais puisque le métal issu du Technocentre ne sera ni traçable ni identifiable, il ne sera pas possible de connaitre la part de matériaux radioactifs présents dans nos environnements.
Si la dissémination de produits contaminés se systématise et qu’aucune limite de quantité n’est imposée, à la longue tous nos espaces de vie deviendront des lieux d’exposition. Un enfant pourra être exposé lorsqu’il sera chez lui et sur son terrain de jeux préféré, dans sa salle de classe, à la cantine et dans la cour de récré, au gymnase, sur son vélo et dans la voiture de ses parents. Les doses seront accumulées au fil des lieux et du temps passé, sans pouvoir être estimées. Il sera impossible de s’assurer que la limite annuelle n’est pas dépassée. Et ces expositions se répèteront tout au long de sa vie. Il n’est donc pas possible d’affirmer que l’exposition aux radiations – et la dose générée – sera de tout temps et partout maitrisée, et donc qu’elle sera sans impact sur la santé.
Combien de personnes exposées ?
Il existait un indicateur, la dose collective, qui permettait de s’assurer que le nombre de personne exposées aux rayonnements ionisants reste limité (13). Mais ce critère n’est plus appliqué depuis la Directive Euratom de 2013. Une véritable régression de la radioprotection.
Quand on envisage d’ajouter de la radioactivité dans le quotidien des gens, il faut estimer le nombre de personnes concernées par des études spécifiques à chaque projet de valorisation et tenir compte de leur impact cumulé. Ne pas fixer de limite à ce nombre et ne rien mettre en place pour qu’elle soit respectée paraît bien irresponsable. Une preuve de plus de la légèreté avec laquelle le sujet est traité.
3/ Risques acceptables : pour qui et pour quoi ?
Les risques induits par l’exposition aux radiations ont dès le départ été sous-estimés. Les limites de dose ont d’ailleurs plusieurs fois été réduites au fil des années (14). Il est désormais prouvé que même de faibles doses, délivrées de façon chronique, entrainent un excès de risque de cancers (15). Plus de recherches sont nécessaires, notamment sur les effets des très faibles doses et sur d’autres pathologies, mais rien ne permet d’affirmer qu’il existe un seuil en dessous duquel les radiations sont sans danger (16).
Si des limites de doses sont fixées, ce n’est donc pas parce qu’en dessous il n’y a aucun risque pour la santé, c’est pour définir ce qui est jugé acceptable et ce qui ne l’est pas dans telle ou telle situation (17).
La dissémination de radioactivité pose donc ces questions de fond : combien de malades et de décès supplémentaires juge-t-on « acceptables » ? Qui en est le juge, et selon quoi, en fonction de quels intérêts ? Est-il acceptable d’augmenter volontairement le risque de maladies et de décès chaque année – quel qu’en soit le nombre – alors qu’ils pourraient être évités, pour le bien d’une filière industrielle ? Pour faciliter la gestion de déchets radioactifs alors qu’il existe d’autres possibilités de les traiter (18) ?
Ce risque « acceptable » qui serait le corollaire de la dissémination de radioactivité dans le domaine public est souvent comparé à celui provoqué par la radioactivité naturellement présente dans notre environnement (19). Mais est-ce vraiment comparable ? Dans un cas il s’agit d’un risque ajouté artificiellement par l’humain et de décider consciemment d’augmenter le nombre de malades et de morts. Dans l’autre il s’agit d’un phénomène naturel, inhérent à notre environnement, que l’humain peut tenter de limiter mais auquel il ne peut se soustraire complètement. Les dangers de la radioactivité naturelle ne sont plus à démontrer, ils font l’objet de réglementations et de campagnes de sensibilisation menées au nom de la santé publique. Alors pourquoi venir ajouter sciemment de la radioactivité dans nos vies ? Toute dose supplémentaire induit des risques supplémentaires. Si on veut assurer une véritable protection de la santé, tout ce qui peut être évité doit être évité.
Absence de preuves d’efficacité des procédés de décontamination et contrôles impossibles pour certains radionucléides, conformité non-garantie de la radioactivité du métal, limite de dose non respectée, risques pour la santé qui pourraient être évités… Les raisons de s’opposer à la dissémination de radioactivité dans notre environnement sont nombreuses et solides. Au fil du temps et des espaces, les personnes exposées aux radiations seront très nombreuses et les effets se cumuleront. Les connaissances sont encore trop limitées, les méthodes trop approximatives, et notre environnement déjà trop contaminé. Nous ne savons rien des effets cocktails, des synergies entre polluants et des effets d’expositions chroniques. Nous savons en revanche que la radioactivité, même à faible dose, provoque des maladies. Nous savons que des projets similaires au Technocentre sont étudiés par la filière nucléaire (20). Nous savons qu’il est possible de faire autrement que d’exposer davantage les populations aux radiations. Nous nous opposerons encore et toujours avec fermeté à la dissémination de radioactivité.
Rédaction : L. Barthélemy •
Pétition Pour des produits Sans-Radioactivité-Ajoutée :
—
Pour aller plus loin :
- Dossier CRIIRAD : Recyclage de déchets radioactifs dans le domaine public
- Courrier à EDF, 17/12/2024 : Demande d’informations relatives au projet Technocentre
- Courrier à l’Autorité de sûreté, 17/12/2024 : Demande d’informations relatives à la valorisation des déchets TFA
- Rapport des producteurs de déchets radioactifs (Andra, CEA, EDF, Framatome, Orano), février 2024 : Possibilités de valorisation de substances de très faible activité autres que métalliques
Notes :
- Ces seuils de libération sont fixés par le code de la santé publique (annexe 13.8, tableau 3). Ils définissent des valeurs limites en concentration pour chaque radionucléide, selon la radiotoxicité de chaque élément. Leur unité est le Bq/kg, c’est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde dans un kilogramme de matière. Par exemple, le seuil défini pour le fer 55 est d’1 million de désintégrations chaque seconde dans un kg. ↩︎
- Compte tenu des différents impacts que ce projet pourrait avoir sur l’aménagement du territoire et le cadre socio-économique et environnemental, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé d’organiser un débat public. Ce débat s’est tenu du 10 octobre 2024 au 7 février 2025.
Le compte-rendu du débat restitue les questions et arguments des publics, les conditions du déroulement du débat et formule des recommandations à EDF. Le bilan est rédigé par le président de la CNDP. Ces deux documents ont été mis en ligne le 7 avril 2025. ↩︎ - « Technocentre : les raisons de notre opposition (1/2) – Un dossier sans preuve et de trop nombreuses questions », février 2025. ↩︎
- Nous parlons ici de la dose efficace, estimée pour le corps entier. ↩︎
- Selon le code de la santé publique (article R1333-6-1, II.3), les produits fabriqués à partir du métal recyclé ne sont pas censés générer une dose supérieure à 10 microsieverts par an (soit 0.01 mSv), quelle que soit leur utilisation. ↩︎
- Nous nous basons sur le rapport pris comme référence par la Directive Euratom/2013/59 : « Derivation of Activity Concentration Values for Exclusion, Exemption and Clearance », International Atomic Energy Agency, 2005 (Safety Reports Series n°44), 161 p. ↩︎
- En général seulement 10 % pour l’exposition externe. ↩︎
- « Les garanties sanitaires ne sont pas au rendez-vous », Trait d’Union 88, décembre 2020, p.19-26. ↩︎
- « The derivation of activity concentration values presented here, however, also is based on the 1 mSv/a public dose criterion for the low probability parameter assumptions ». Rapport AIEA de 2005 cité précédemment, p.15. ↩︎
- « Estimation du temps passé à l’intérieur du logement de la population française », A. Zeghoun & al., 2008. ↩︎
- Population française en 2008 : 64.38 millions. Source : INSEE ↩︎
- Radiation protection 122 : Pratical use of the concepts of clearance and exemption Part I – Guidance on General Clearance Levels for Practices. Recommendations of the Group of Experts established under the terms of Article 31 of the Euratom Treaty, Commission Européenne, 2000. ↩︎
- Par exemple, si la dose individuelle est fixée à 10 microsieverts/an, le nombre de personnes exposées ne doit pas dépasser 100 000 quand une limite de dose collective d’1 Homme Sievert par an est établie (10 µSv fois 100 000 = 1 Sv). ↩︎
- En 1977 la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) recommandait une limite de dose de 5 mSv/an pour le public. En 1990 elle recommandait une limite de 1mSv/an en moyenne avec un maximum de 5mSv/an sur 5 ans, puis en 2007 1mSv/an. ↩︎
- L’étude INWORKS porte sur les risques induits par la dose cumulée au fil de la vie professionnelle. Elle est basée sur les données individuelles de plus de 300 000 travailleurs français, américains et britanniques, suivis en moyenne 27 ans. ↩︎
- Synthèse des connaissances actuelles sur les risques sanitaires des faibles doses de rayonnements ionisants. Rapport IRSN n°2024-00203, mars 2024. ↩︎
- Ce qui est acceptable varie selon la situation. En France la limite de dose est à 1mSv/an pour le public. Pour les travailleurs elle est à 6 ou à 20 mSv/an. En cas d’accident nucléaire, la limite passe à 100 mSv/an pour tout le monde (5 fois le maximum autorisé pour les professionnels les plus exposés). ↩︎
- Rappelons que d’autres solutions étaient envisagées et doivent encore être étudiées. Par exemple réutiliser les matériaux contaminés dans la filière nucléaire, densifier les déchets pour réduire leur volume, limiter la production de déchets, créer d’autres centres de stockage. Avis n° 2016-AV-0258 et avis n° 2020-AV-0356 de l’Autorité de sûreté nucléaire sur les études concernant la gestion des déchets de très faible activité (TFA), PNGMDR 2022-2026 : actions TFA.1 à TFA.11 ↩︎
- Les rayonnements du cosmos ou telluriques par exemple. ↩︎
- Trois projets de valorisation de déchets radioactifs (autres que métalliques) sont recensés dans le compte-rendu de la 83e réunion du groupe de travail du PNGMDR (plan national de gestion des matières et déchets radioactifs) qui s’est tenue en juin 2024. Ils concernent la réutilisation d’autres substances contaminées (bétons, boues nitratées, huiles perfluorées). Les producteurs de déchets radioactifs (Andra, CEA, EDF, Framatome, Orano) ont par ailleurs insisté sur « la nécessité de faire évoluer le cadre réglementaire afin de pouvoir déployer les projets » et annoncé étudier les prérequis à satisfaire pour la valorisation de terres et de gravats contaminés. Ils ont rendu en février 2024 un rapport conjoint sur les possibilités de valorisation de substances de très faible activité autres que métalliques. On y apprend par ailleurs qu’un projet de valorisation de plomb radioactif est envisagé en Loire-Atlantique. ↩︎
ANALYSER • INFORMER • REVENDIQUER
La CRIIRAD est une association d’intérêt général qui produit et diffuse des informations indépendantes des autorités et des industriels, sur la base de ses recherches et des résultats issus de son propre laboratoire scientifique.
Grâce à votre soutien, nous agissons depuis 38 ans, pour que chacune et chacun dispose des informations et des moyens nécessaires pour se prémunir des risques liés à la radioactivité.
Nos actions nécessitent du temps et des ressources.
COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Faire un don ponctuel
Un don ponctuel, même petit, est un acte de soutien important pour l’association
Faire un don régulier
Si vous le pouvez, préférez un don régulier (mensuel, trimestriel, annuel).
Devenir adhérent·e
L’adhésion est un soutien sur le long terme et vous fait prendre part à la vie associative.
Être bénévole sur un salon
Aidez-nous à tenir un stand CRIIRAD sur un salon ou une foire près de chez vous.
Si vous êtes imposable, les cotisations et les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.