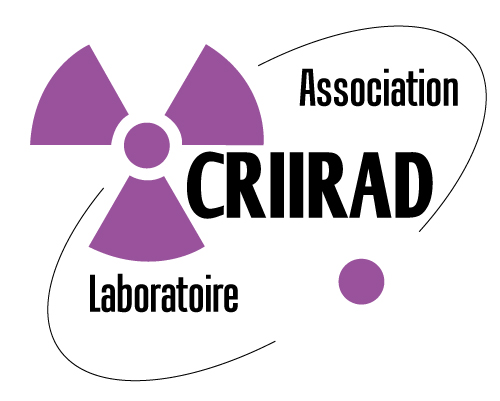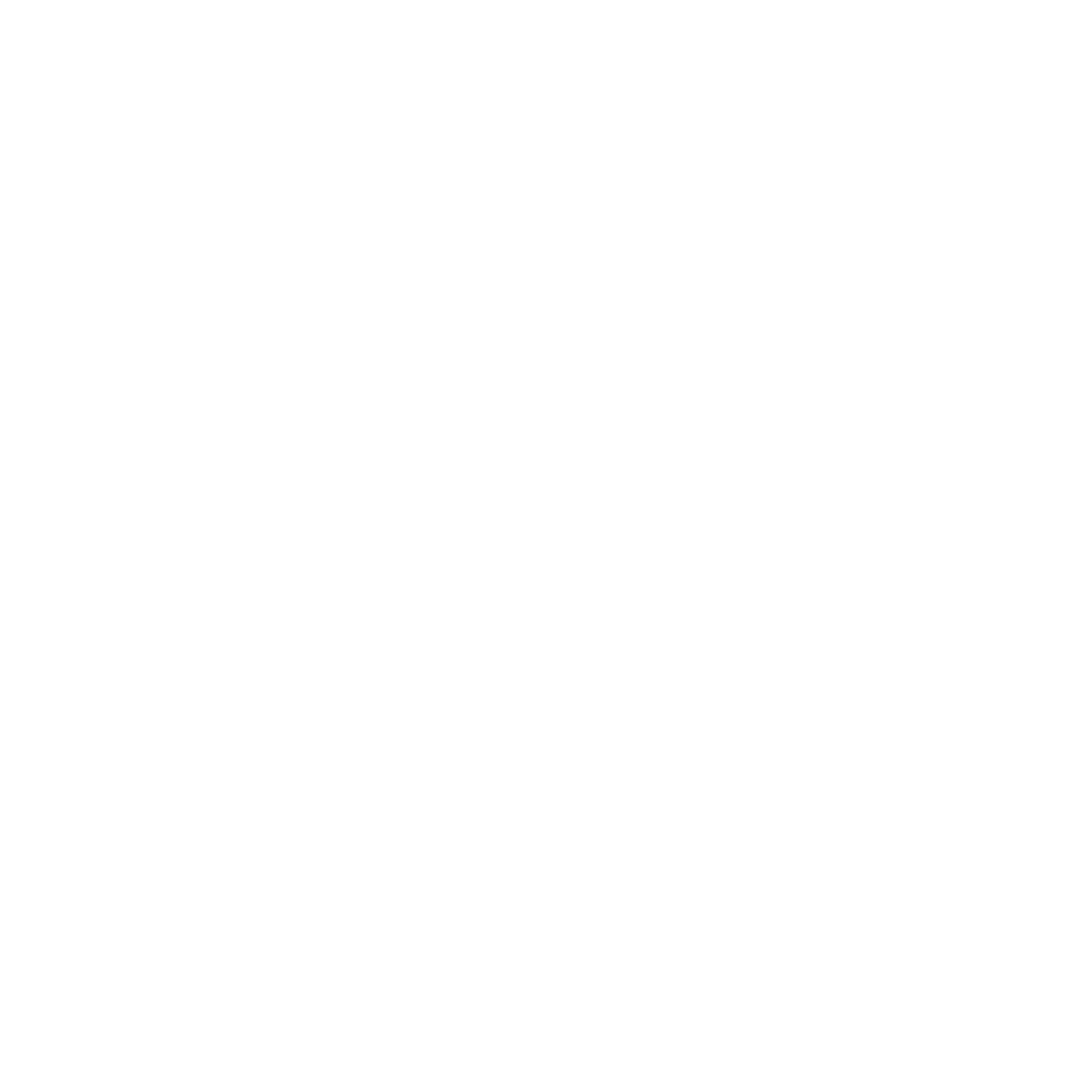🕒 Lecture 15 min.
Un dossier sans preuve et de trop nombreuses questions
À la veille de la clôture du débat public sur le projet d’usine visant à recycler certains déchets de la filière nucléaire et à les introduire dans le domaine public, la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) fait le point sur les très nombreuses questions que pose le Technocentre de Fessenheim. Absence de preuves d’efficacité des procédés de décontamination, contrôles inadaptés voire impossibles, conformité non-garantie : tour d’horizon des raisons qui fondent notre opposition.
La CRIIRAD lutte depuis longtemps contre l’ajout de radioactivité dans les biens de consommation et les matériaux de construction (1). Non par lubie, mais par objectivité. Les rayonnements ionisants émis par les matières radioactives ont des impacts sur le vivant, même à faible dose (2). Contaminer nos lieux de vie et les objets qui nous entourent avec des éléments radioactifs est risqué pour notre santé.
Le Technocentre de Fessenheim, projet porté par EDF, pourrait pourtant rendre bien réel dès 2031 l’ajout de radioactivité dans nos vies. Cette usine serait une première en France : des déchets radioactifs en métal, provenant d’installations nucléaires, seraient recyclés après avoir été partiellement décontaminés. Le métal ainsi produit pourrait être utilisé pour fabriquer tout et n’importe quoi, sans aucune restriction, sans aucun contrôle, sans aucune traçabilité. Du moment que sa radioactivité ne dépasse pas certains seuils (3). À la veille de la fin d’un débat de plusieurs mois (4), la CRIIRAD souhaite faire le point sur les problèmes que soulève le Technocentre et les trop nombreuses questions qui restent sans réponses.
Manque de données
Le dossier conçu par EDF pour informer les citoyennes et citoyens sur l’usine, son fonctionnement et ses impacts contient très peu de données chiffrées et étayées (5). Pourtant EDF a fait des essais en laboratoire durant 2 ans, de 2021 à 2023 (6). Et sa filiale Cyclife exploite une usine fonctionnant depuis longtemps sur le même principe en Suède. Le dossier ne contient pas non plus d’étude d’impact (en cours d’élaboration), et sans même s’appuyer sur des résultats préliminaires, pose des affirmations sur l’absence d’effet pour l’environnement et la santé. Des conclusions avancées sans preuve, qui ne reposent sur aucune démonstration.
EDF a complété son dossier, moins d’un mois avant la fin du débat, par 2 fiches thématiques (3 et 4 pages chacune) (7) livrant quelques estimations des quantités d’eau prélevées chaque année et des polluants rejetés dans l’air par le Technocentre. Les émissions de CO2 – qui n’incluent pas celles liées aux nombreux transports et travaux d’aménagement inhérents au projet – sont comparées à celles d’une centrale à charbon. Le fondement scientifique d’une telle opération interroge, puisque les 2 installations n’ont rien en commun. Les rejets radioactifs ne sont en revanche comparés à ceux d’aucune installation. Dans une fonderie classique ils seraient insignifiants, puisque le métal ne contient normalement pas de radionucléides artificiels et quasiment pas de radionucléides naturels. Comparé à une centrale de production d’électricité nucléaire, le Technocentre pourrait rejeter chaque année dans l’air jusqu’à 2,7 fois plus de carbone 14 que les 4 réacteurs de la centrale du Tricastin (8).
Sur les 140 pages constituant l’ensemble du dossier soumis au débat – ce qui est relativement peu pour un projet novateur de cette ampleur – très peu d’éléments concernent le volet « radioactivité ». C’est pourtant la spécificité de cette usine, le Technocentre n’est pas une fonderie classique. Il s’agit d’y apporter des centaines de milliers de mètres cubes de déchets, qui devront être triés en fonction de leur radioactivité (type de contamination et concentration) et découpés. Certains devront être décapés manuellement ou chimiquement pour les rendre moins radioactifs avant d’être fondus, la fusion permettant d’extraire une partie des matières radioactives du métal. À chaque étape, la radioactivité est un paramètre-clé et induit des risques spécifiques.
Vous avez dit déchets ?
Si une substance a une utilisation possible, même si celle-ci est théorique et n’est pas mise en œuvre, elle n’est officiellement pas un “déchet” ni comptabilisée comme tel, c’est une “matière valorisable”. Nous faisons le choix de continuer à nommer “déchets” les matériaux destinés au Technocentre, car avant un changement de réglementation en 2022 pour autoriser leur réutilisation (9), ces composants faisaient bel et bien partie des déchets de l’industrie nucléaire.
Les contrôles, exhaustifs ou non ?
Bien d’autres points auraient mérité d’être précisés pour permettre un débat éclairé. En premier lieu, les contrôles radiologiques et la méthode de caractérisation des déchets qui y seront envoyés. Seront-ils exhaustifs, identifiant précisément chaque radionucléide présent et à quelle concentration ? Ou au contraire des modèles-types de contamination seront-ils utilisés et seuls quelques radionucléides, facilement détectables, seront-ils recherchés ? La même question se pose pour les contrôles à l’arrivée des déchets et à chaque traitement qu’ils subiront. Connaitre précisément leur contamination (concentration et nature des radionucléides), avant et pendant leur traitement, est la pierre-angulaire pour qui veut limiter les risques, maitriser les opérations et jauger de leur efficacité.
Mais obtenir une caractérisation radiologique exhaustive et précise est très difficile. Pour plusieurs raisons. Certains rayonnements sont facilement arrêtés par la matière. Ils sont donc difficilement détectables, voire indétectables, lorsqu’ils sont dans le métal ou à l’intérieur des composants. De plus, les équipements, par exemple les générateurs de vapeur, ne sont pas tous contaminés de la même manière (leurs lieux, conditions et durées d’utilisation induisent des variations). Et sur une même pièce la nature et la quantité d’éléments radioactifs peuvent fortement varier d’une zone à une autre. Un pas de vis ou une rayure peuvent concentrer une contamination beaucoup plus importante que le reste de la surface. Les pièces seront-elles entièrement démontées, tous les éléments désassemblés avant d’être contrôlés ? Ces contrôles se feront ils uniquement à la surface des parties accessibles ? Sur leur intégralité ou sur quelques parties ?
On imagine aisément le temps, et donc le coût, de vérifications exhaustives. Le dossier d’EDF ne précise rien sur les contrôles préalables effectués par les producteurs de déchets. Il évoque des contrôles surfaciques (donc en surface) des déchets arrivés sur place mais ne détaille pas les procédures. Il précise toutefois que les méthodes de mesure seront « adaptées aux contraintes industrielles », « notamment à la cadence de production » (10). L’exhaustivité ne semble donc pas l’option privilégiée.
La décontamination, efficace ou non ?

Démantèlement d’un réacteur © SRS 2011, US DOE, WikimediaCommons
Avant d’être fondus, certains déchets devront être décontaminés une première fois pour réduire leur activité radiologique. En limant mécaniquement leur surface ou par des rinçages chimiques. Là encore, EDF ne détaille ni les procédés, ni leurs conditions d’application. Volume de déchets concernés, nature et devenir des poussières, des vapeurs et des produits chimiques, dispositifs de protection des travailleurs et de l’environnement, taux de décontamination atteint pour chaque radionucléide par ces traitements pré-fusion ?
L’efficacité de la décontamination par la fusion n’est pas non plus détaillée, aucun résultat de test n’est avancé. Seulement 2 pages recto-verso y sont accordées dans l’ensemble du dossier (11). L’unique donnée chiffrée de répartition d’un élément chimique durant la fusion livrée par EDF est celle de l’uranium (12) : il n’en resterait que des traces dans le métal.
Mais au fil des lignes, dans d’autres parties du dossier, on apprend que la fusion est très peu efficace sur les formes radioactives des éléments qui ont des propriétés physico-chimiques proches du fer, comme le cobalt ou le nickel. Ils resteront donc dans le métal (13), tout comme « une partie » du carbone 14 (14). EDF ne précise pas en quelles proportions.
Quel est le devenir de chaque radionucléide ? Qu’est-ce qui va migrer dans la couche superficielle du métal fondu qui sera écrémée (le laitier), qu’est-ce qui va s’incruster dans les parois du four (le réfractaire), qu’est-ce qui va être vaporisé en gaz et en poussières, et qu’est-ce qui sera retenu par les filtres ou rejeté dans l’atmosphère ? Et en quelles proportions ? En d’autres termes : quel est le facteur de décontamination du procédé pour chaque radionucléide ? Aucune démonstration du niveau d’efficacité de la fusion n’est apportée. Pourtant, c’est là-dessus qu’est fondé tout le projet.
Une conformité non garantie
Pour ce qui est des contrôles réalisés sur le métal après avoir passé l’étape de la fusion, là non plus, EDF ne fournit aucune précision permettant de dire si la méthode est adaptée et les mesures suffisantes. Combien de prélèvements seront faits sur le métal en fusion ? Comment seront-ils analysés ? Quelles seront les limites de détection ? Les radionucléides encore présents dans le métal seront-ils un à un recherchés ou des modèles-types de contamination seront-ils utilisés pour déduire la présence d’un ensemble de radioéléments à partir de l’identification de quelques-uns ? Nous avons interrogé EDF à ce sujet en décembre 2024 (voir le courrier en bas de cet article). Nous attendons des réponses.
De plus, la forme choisie pour les lingots produits (20 kg) ne facilitera pas leur contrôle radiologique, puisque plus la pièce est petite et fine, plus il est possible d’y détecter la présence de radionucléides. Donc non seulement la radioactivité ne sera pas totalement éliminée du métal recyclé (et pourra refaire surface lorsqu’il sera transformé), mais elle ne sera pas entièrement détectable. Comment EDF pourra garantir que la concentration maximale définie pour chaque radionucléide sera respectée ?
Qui plus est, même si les caractéristiques radiologiques du métal sont respectées, il n’est pas garanti que l’exposition aux radiations émises par les objets fabriqués avec ce métal restera sous la limite fixée (15). Car la méthode utilisée pour estimer la dose reçue (16) en fonction de l’activité radiologique du métal repose sur des scenarios associés à des probabilités qui sont très discutables (17). Nous reviendrons sur ces éléments dans une seconde publication.
Trop de questions relatives à l’efficacité des contrôles radiologiques et des décontaminations restent en suspens. Normalement le métal n’est pas radioactif. Celui qui sortira du Technocentre le sera. Ajouter de la radioactivité artificielle dans notre environnement, en contaminant des ressources naturelles ou des biens de consommation, revient à augmenter les expositions auxquelles nous sommes déjà soumis. Et donc à induire des risques supplémentaires (cancers, maladies cardio-vasculaires, etc.).
Ces pollutions et ces risques sont les conséquences directes de choix industriels. Il n’est pas acceptable que le prix soit payé par la population, sous forme d’atteintes à sa santé. La CRIIRAD continuera donc à se mobiliser contre le Technocentre et contre toute dissémination de radioactivité.
Rédaction : L. Barthélemy •
Pétition Pour des produits Sans-Radioactivité-Ajoutée :
—
Pour aller plus loin :
- Dossier CRIIRAD : Recyclage de déchets radioactifs dans le domaine public
- Courrier à EDF, 17/12/2024 : Demande d’informations relatives au projet Technocentre
Notes :
- Voir par exemple le Dossier d’information du 29/11/2009 sur la mobilisation contre l’ajout de substances radioactives dans les biens de consommation et les matériaux de construction. ↩︎
- Synthèse des connaissances actuelles sur les risques sanitaires des faibles doses de rayonnements ionisants – Rapport IRSN 2024-00203 ; Etude INWORKS : résultats publiés en 2023 et 2024. ↩︎
- Ces seuils définissent des valeurs limite en concentration pour chaque radionucléide, selon la radiotoxicité de chaque élément (annexe 13.8 du code de la santé publique, tableau 3). Leur unité est le Bq/kg, c’est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde dans un kilogramme de matière. Par exemple, le seuil défini pour le fer 55 est d’1 million de désintégrations chaque seconde dans un kg. ↩︎
- Compte tenu des différents impacts que ce projet pourrait avoir sur l’aménagement du territoire et le cadre socio-économique et environnemental, la Commission nationale du débat public a décidé d’organiser un débat public du 10 octobre 2024 au 7 février 2025 : https://www.debatpublic.fr/projet-technocentre-fessenheim ↩︎
- Dossier du maître d’ouvrage du projet Technocentre, septembre 2024 (97 pages), Feuille de route du projet Technocentre, février 2023 (36 pages). ↩︎
- Feuille de route, p.32 ↩︎
- Fiche thématique « La gestion de l’eau et les rejets liquides », Fiche thématique « Les effluents gazeux », 14 janvier 2025. ↩︎
- Le carbone 14 rejeté en 2022 par la centrale du Tricastin présentait une activité de 516 GBq/an (Source : rapport environnemental annuel 2022). La fiche Effluents gazeux du Technocentre (p.3) présente pour le carbone 14 un rejet estimé sur la base d’hypothèses majorantes d’une activité de 1400 GBq/an, ce qui est égale à 2.7 fois les rejets du Tricastin (1 400 000 000 000 / 516 000 000 000 = 2.713). ↩︎
- Décrets 2022-174 et 2022-175 du 14 février 2022 relatifs à la mise en œuvre d’opérations de valorisation de substances faiblement radioactives et aux substances éligibles à ces opérations. ↩︎
- Feuille de route, p.22 ↩︎
- Feuille de route, partie 9 « Eléments démontrant le caractère décontaminant du procédé », p.31-32. ; Dossier du maître d’ouvrage, partie 2.1 « Le procédé de fusion », p.46-47. ↩︎
- Feuille de route, Figure 12, p.32 ↩︎
- Feuille de route, p.19 ↩︎
- Fiche thématique « Les effluents gazeux », p.3 ↩︎
- Selon le code de la santé publique (article R1333-6-1, II.3), les produits fabriqués à partir du métal recyclé ne sont pas censés générer une dose supérieure à 10 microsieverts par an, quelle que soit leur utilisation. ↩︎
- La dose (plus précisément la dose efficace, exprimée en sievert, Sv) est l’indicateur utilisé pour évaluer le risque sanitaire induit par l’exposition aux rayonnements ionisants. ↩︎
- Trait d’Union 88, décembre 2020, p.19-26 ↩︎
ANALYSER • INFORMER • REVENDIQUER
La CRIIRAD est une association d’intérêt général qui produit et diffuse des informations indépendantes des autorités et des industriels, sur la base de ses recherches et des résultats issus de son propre laboratoire scientifique.
Grâce à votre soutien, nous agissons depuis 38 ans, pour que chacune et chacun dispose des informations et des moyens nécessaires pour se prémunir des risques liés à la radioactivité.
Nos actions nécessitent du temps et des ressources.
COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Faire un don ponctuel
Un don ponctuel, même petit, est un acte de soutien important pour l’association
Faire un don régulier
Si vous le pouvez, préférez un don régulier (mensuel, trimestriel, annuel).
Devenir adhérent·e
L’adhésion est un soutien sur le long terme et vous fait prendre part à la vie associative.
Être bénévole sur un salon
Aidez-nous à tenir un stand CRIIRAD sur un salon ou une foire près de chez vous.
Si vous êtes imposable, les cotisations et les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.